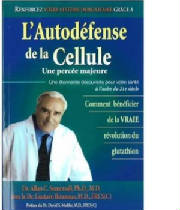Le système immunitaire, un aperçu
|
Enter subhead content here
BREF APERÇU DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
Résumé du système immunitaire préparé par le Dr Gustavo Bounous, md, frcsc, à l’intention d’un groupe d’étudiants en médecine à l’Université McGill.
Extrait de L’Autodéfense de la cellule, par le Dr Allan Sommersall, Ph.D, md, , pages 108 à 121.
Enter content herelPour assurer votre protection continue, le corps est pourvu d’un certain nombre de systèmes anatomiques, physiologiques et biochimiques qui fonctionnent en harmonie afin d’assurer la défense de votre santé et de votre vie. Les principaux sont énumérés dans le tableau 1. Par ailleurs vous trouverez ci-après l’énumération de quelques-unes de leurs caractéristiques principales, accompagnées d’interventions clés pour chacun d’eux.lLA PEAU. La peau constitue le plus grand organe du corps humain. Elle remplit plusieurs fonctions cruciales dont celle de servir de barrière efficace contre toutes les menaces liées à l’environnement, qu’elles soient physiques ou biologiques. Lorsqu’une personne souffre de brûlures sévères, par exemple, il y a crise médicale en raison des défis extrêmes que cet état représente pour la défense de l’organisme. La clé : éviter la déshydratation. Éviter les dommages causés par le soleil. Soigner les brûlures.lL’APPAREIL RESPIRATOIRE. Les revêtements intérieurs spéciaux des voies aériennes, y compris des voies nasales et de la gorge, protègent les poumons contre l’inhalation de particules de matière étrangère, mais aussi de fumée et de produits chimiques. Une toux se déclenche habituellement afin de faciliter l’expulsion de ces substances. La clé : éviter l’air pollué et la fumée de cigarette.lLES VOIES GASTRO-INTESTINALES. La nourriture et l’eau que l’on ingère quotidiennement franchissent presque 40 pieds (12,19 m) de tuyaux complexes, trajet au cours duquel leur digestion et leur absorption sont soigneusement contrôlées sur le plan physiologique. Les vomissements et la diarrhée sont des mécanismes protecteurs visant à vider ces voies. Des sécrétions chimiques et des revêtements muqueux spéciaux assurent la protection contre les contenus nocifs qui demeurent. La clé : exclure les poisons ingérés et les métabolites. Manger une nourriture saine.lLE FOIE. Le traitement central des déchets qui pénètrent dans les tissus du corps, ou qui se forment en eux, s’effectue dans le foie. De nombreux systèmes enzymatiques complexes y convertissent des substances nocives en déchets inoffensifs qui sont sécrétés dans le courant sanguin et nettoyés par les reins ou l’arbre biliaire (urine et bile). Une insuffisance hépatique sévère peut permettre que des substances toxiques se rendent au cerveau et entraîne habituellement un état d’urgence. La clé : éviter les toxicomanies et l’usage abusif des additifs alimentaires et des substances toxiques.lLA MOELLE OSSEUSE. La moelle osseuse est un organe très productif. Toutes les lignées de cellules sanguines y sont produites, y compris les cellules du système immunitaire. Aujourd’hui, les transplantations de moelle osseuse sont effectuées comme interventions salvatrices afin de restaurer la production de cellules dans certains états cliniques. La clé : un régime alimentaire sain et équilibré. L’exercice modéré.lLES GANGLIONS LYMPHATIQUES. La plupart d’entre nous ont fait, à un moment ou à un autre, l’expérience d’avoir des ganglions ou nœuds lymphatiques enflés. Cet état indique habituellement la présence d’une infection, d’une inflammation réactionnelle, voire d’un cancer. Les ganglions lymphatiques sont de petites usines à l’usage des cellules immunocompétentes pour leurs activités défensives. Certaines cellules produisent des anticorps, véritables petites armes offensives circulantes très efficaces, qui produisent à leur tour toute une cascade d’armes chimiques et biologiques dans l’espoir d’assurer la victoire du système immunitaire sur l’ennemi. La clé : surveiller et signaler.LlTableau 1 : Aperçu du système de protection du corpslll
l
EXTERNE
LA PEAU
Barrière
MEMBRANES ÉPITHÉLIALES
Voies respiratoires
Respiration
Voies gastro-intestinales
Alimentation
Voies uro-génitales
Intimité
Conduit auditif
Audition
l
INTERNE
VISCÈRES
Foie
Dépollution
Reins
Filtration
Ganglions lymphatiques et rate
Traitement
Moelle osseuse
Production
Thymus
Maturation
CELLULES
Système immunitaire
Forces défensives
MOLÉCULES
Anticorps
Armes
Cytokines
Déclencheurs
Antioxydants
Stabilisants
IMPORTANCE DU SYSTÈME IMMUNITAIRElChaque jour et de toutes sortes de manières, votre corps est agressé de toutes parts, mais votre système immunitaire veille et assure votre protection, que vous soyez malade ou en bonne santé. Imaginez un peu à quel point votre santé se voit continuellement menacée par les bactéries, les virus, les radiations, les produits chimiques, tant internes qu’externes, les mutations diverses, les traumatismes, etc. En fait, lorsque nous réfléchissons à toutes les agressions potentielles auxquelles nous sommes soumis chaque jour, nous devrions nous étonner de ne pas être malades ou souffrants plus souvent. Aucun de nous n’est une île et nous n’habitons pas dans une biosphère contrôlée. Nous vivons, au contraire, au sein d’un univers de micro-organismes hostiles qui font tout ce qu’ils peuvent pour survivre à nos dépens, dans un environnement où abondent les produits chimiques et les radiations qui pourraient provoquer notre annihilation, pour peu que nous soyons imprudents.
l
Par conséquent nous ne saurions trop souligner l’importance capitale du système immunitaire. Lorsque tous les professionnels de la santé ont donné leur pleine mesure, on doit quand même attendre pour voir comment chaque personne réagira devant toute menace à sa santé. Dans un certain sens, c’est à cette réaction qu’on peut mesurer la véritable forme physique de quelqu’un.
lDevant toute agression ou provocation, vos cellules ripostent en mettant en branle toute une série d’événements intra et extracellulaires, dont la somme constitue ce qu’on appelle généralement la réponse immunitaire. Elles déclarent la guerre à l’envahisseur. Elles peuvent perdre une bataille de temps à autre, mais elles doivent absolument gagner la guerre! Dans la réalité, votre santé repose sur vous ou, plus précisément, sur votre système immunitaire. En fait, c’est votre vie même qui en dépend.
l
Depuis quelques décennies, les scientifiques mènent des études approfondies sur le système immunitaire. Ils ont fait d’énormes progrès dans la compréhension de ses mécanismes complexes. La poursuite de toutes ces recherches ne peut qu’avoir des retombées positives de plus en plus nombreuses et généralisées pour ce qui concerne la maladie et la santé. Mais vous n’avez pas besoin d’attendre, vous pouvez agir dès maintenant.lLES DÉFISlLe système immunitaire doit affronter quatre défis importants :
l
1. Identifier l’ennemi. Le système doit pouvoir distinguer entre soi et non-soi, ami ou ennemi, pour vous ou contre vous.l2. Exercer une immuno-surveillance. Il est important que la réponse soit spécifique, mais il faut aussi que le système demeure en état d’alerte afin d’assurer une défense rapide et suffisante pour terrasser l’ennemi avant qu’il vous porte un coup sérieux.l3. Riposter. Il doit être efficace et total dans sa riposte afin d’anéantir l’agression de tout ennemi identifié. Pour les cellules, il s’agit d’une guerre et non d’une simple partie de plaisir. Elles visent l’extermination.l4. Savoir s’arrêter ou s’éteindre lorsque le travail est fait. La réponse immunitaire est véritablement une réaction de défense. Elle ne doit jamais faire l’excès de zèle au point de devenir offensive contre le corps même. Des contrôles doivent s’exercer.lLe système immunitaire doit affronter tous ces défis avec succès et de manière simultanée. Il dispose pour ce faire de tout un arsenal de cellules spécialisées qui exécutent leurs diverses fonctions d’une manière hautement coordonnée. La régulation interne du système entier repose sur l’encodage génétique de lignées de cellules différenciées. Seules les cellules du système immunitaire peuvent suffire à la tâche. Dans la meilleure des hypothèses, les interventions cliniques tentent seulement de tirer parti de ce que la nature fait elle-même continuellement et avec une grande efficacité de par la conception même des cellules. llLES RÉPONSESlDe façon très générale, nous pouvons dire que, en état de santé comme de maladie, la plupart des agressions que subit votre corps provoquent deux conséquences importantes : Premièrement il se produit une réaction physiologique de tous les organes à la fois, agissant à l’unisson afin d’établir des priorités et de répartir les ressources du corps. Ensuite vient la réponse cellulaire qui se met immédiatement en mode de défense au niveau microscopique.
l
1. La réaction GÉNÉRALE ou syndrome d’adaptation au stress:lIl s’agit d’un mode de riposte courant, par lequel le corps se prépare à lutter ou à fuir. Tout s’accomplit spontanément par actions réflexes.lÀ l’échelle macroscopique : Les systèmes physiologiques les plus importants du corps humain savent s’adapter selon les changements de circonstances afin de toujours maximiser vos chances de survie et protéger votre santé. Vous pouvez alors éprouver différents symptômes comme, par exemple, une accélération des battements du cœur, de la fièvre, la coagulation du sang exposé, des variations du débit urinaire, de la circulation, du transit intestinal, du tonus musculaire, etc. Le résultat global visé est de maintenir ou de restaurer l’homéostasie nécessaire à un corps en santé. C’est Claude Bernard, le célèbre physiologiste français du 19ième siècle, qui, le premier, a observé que « la constance du milieu intérieur (c’est-à-dire l’homéostasie) est la condition d’une vie organique autonome ».La vie est donc maintenue dans l’état de santé à l’intérieur d’une très étroite bande de jeu des différentes variables physiologiques. Des mécanismes de rétroaction et de contrôle réflexes permettent au corps de s’adapter rapidement et efficacement devant une agression. Il arrive que notre survie même soit en jeu, mais à tout le moins c’est l’état de santé général qui se trouve déterminé par cette capacité d’adaptation. Elle constitue la plus précieuse indication d’une santé robuste et dynamique. lll2. La réponse immune et CELLULAIRE
l
Comme nous l’avons déjà noté, cette deuxième conséquence majeure résultant d’une agression faite au corps vise une cible localisée avant tout. Elle peut prendre différentes for4mes, mais sa stratégie globale pourrait se diviser grosso modo en deux catégories : une réponse inflammatoire et une réponse immunitaire.llLa réponse inflammatoire est davantage pathologique, en quelque sorte, mais pour l’essentiel, c’est un processus qui met en branle un complexe dynamique de réactions locales affectant les vaisseaux sanguins et les tissus voisins en réponse à un traumatisme ou à une stimulation anormale provoqués par des agents physiques, chimiques ou biologiques. Les signes cardinaux classiques de l’inflammation sont la rougeur, la chaleur, l’œdème et la douleur Une fonction peut aussi se trouver affectée.Habituellement, les changements de type inflammatoire sont très visibles. Ils se produisent dans les tissus, même s’ils sont déclenchés par une activité cellulaire complexe.llLa réponse immunitaire, par contre, est habituellement invisible, bien que tout aussi importante. Comme nous l’avons déjà fait observer, il s’agit d’une véritable guerre des cellules. La cellule est attaquée et se prépare à riposter. llÀ l’échelle MICROSCOPIQUE : chaque cellule est une entité vivante pourvue, elle aussi, de caractéristiques homéostatiques, même si elle fait partie de l’univers microscopique. Elle exploite la biologie moléculaire et la génétique d’abord et avant tout pour se protéger elle-même. Ensuite seulement les cellules spécifiques du système immunitaire pourront prendre part à toute réponse collective orchestrée, différenciée et très spécifique. Ces représailles spontanées sont très efficaces pour la défense de la vie organique et sont soumises à des mécanismes de régulation.lÀ l’intérieur du corps, trois défis majeurs se posent à toutes les cellules :
· Les radicaux libres (fragments moléculaires « hyper-réactifs »)· L’oxydation (les produits oxygénés)· Les xénobiotiques (les poisons) ll
Les radicaux libres:
lLes liaisons chimiques entre les atomes impliquent habituellement une mise en commun de paires d’électrons. Ce qui constitue des molécules covalentes stables. Lorsqu’un lien chimique est brisé à la suite d’une réaction quelconque, les fragments qui en résultent ont chacun des électrons « impairs », ce qui les rend très instables et donc très réactifs. Ils deviennent alors extrêmement réactifs et se mettent à attaquer d’autres molécules plus sensibles, à la recherche d’électrons pour se rééquilibrer. Parmi ces molécules se trouvent les acides nucléiques si importants et les protéines; lorsque l’ADN ou l’ARN sont touchés, c’est le contrôle génétique de l’activité cellulaire qui se trouve compromis. Les radicaux libres doivent donc être étouffés avant qu’ils n'endommagent les tissus.l
l
L’oxydation: l
Les réactions chimiques les plus importantes qui ont lieu à l’intérieur des cellules impliquent souvent (en fait, habituellement) l’oxygène ou d’autres systèmes d’oxydoréduction. Le simple transfert d’un électron ou d’un proton d’un atome à un autre comporte des conséquences majeures. L’oxygène constitue la clé omniprésente qu’il faut contrôler. Lorsqu’une oxydation prématurée a lieu dans les cellules où des radicaux superposés (hydroxy- et péroxy-) servent d’intermédiaires létaux, les cellules peuvent être détruites. Ces intermédiaires toxiques doivent donc être neutralisés avant qu’ils ne provoquent des réactions en cascade conduisant à la mort des cellules.
l
Les xénobiotiques:
Les produits chimiques toxiques peuvent être ingérés et se retrouver dans la circulation des fluides ou dans les tissus du corps. Des produits de la digestion et du métabolisme peuvent aussi devenir toxiques pour les cellules. Ils doivent aussi être neutralisés avant de causer des dommages. Ceux qui se forment à l’intérieur de la cellule auront avantage à y être aussi neutralisés. D’autres xénobiotiques peuvent être transportés jusqu’au foie, où ils seront neutralisés et transformés en produits plus inoffensifs qui seront plus tard excrétés par les reins et les voies biliaires.
l
l
.................................. LA PUISSANCE DÉFENSIVE
l
ANTIGÈNE: Il peut s’agir de toute macromolécule qui, une fois repérée comme élément étranger par le système immunitaire, stimule une réponse immunitaire. Cette réponse est toujours spécifique. l
l
ANTICORPS. Font partie d’une grande variété de protéines sécrétées dans le corps d’un animal en présence de différents antigènes et réagissent de façon spécifique pour chacun de ces antigènes en déclenchant divers résultats. Les anticorps peuvent ralentir des virus et des bactéries et les tuer. l
l
RÉPONSE PRIMAIRE. Formation d’anticorps après une première exposition à un antigène particulier. l
l
RÉPONSE SECONDAIRE. Formation d’anticorps après une deuxième exposition au même antigène. C’est une réponse accélérée (plus rapide que la première), et amplifiée (c’est-à-dire beaucoup plus importante). l
l
CELLULES "T". Une variété de lymphocytes issus de la moelle osseuse et traités par leur passage dans le thymus; ils sont en outre pourvus de récepteurs spécifiques. En général, les lymphocytes T d’un certain type ont une fonction effectrice ou régulatrice, alors qu’un autre type sont des cellules « tueuses ». l
l
CELLULES "B". Ces lymphocytes sont produits principalement dans la moelle osseuse. Ils sont caractérisés par l’expression des immunoglobulines présentes dans leur surface et formant des récepteurs spécifiques. Lorsque stimulés, ils prolifèrent, grossissent pour devenir des plasmocytes qui produisent et sécrètent des anticorps. lLes deux types de cellules T et B sont pourvus de récepteurs spécifiques qui se combinent aux substances étrangères (ou antigènes) de structure complémentaire et prolifèrent ensuite de façon clonale pour devenir des millions. Il s’agit là d’une particularité unique au système immunitaire.
lCELLULES PRÉSENTANT L’ANTIGÈNE. Il y a plusieurs classes de cellules morphologiquement distinctes qui traitent les antigènes de façon non spécifique et les préparent pour qu’ils soient présentés aux lymphocytes T auxiliaires.
lLYMPHOCYTES "T" AUXILIAIRES. Ce sont de petits lymphocytes, mais ils agissent comme les commandants en chef du système immunitaire. Ils reconnaissent les antigènes traités et se mettent immédiatement à l’œuvre stimulant à leur tour l’activation d’autres membres de la force défensive. On les distingue par des marqueurs CD4. llCELLULES "T" TUEUSES. Activés par les cellules T auxiliaires, ces parachutistes n’ont qu’un seul rôle : reconnaître et détruire l’ennemi avant qu’il réussisse à se multiplier. Ils tuent les cellules qui sont infectées par un virus et poursuivent leur activité de surveillance. On les distingue par des marqueurs CD8.lLYMPHOCYTES "B". Activés eux aussi par les lymphocytes T auxiliaires, les lymphocytes B se spécialisent dans la guerre chimique. Ils produisent des anticorps qui circulent dans les fluides corporels à la recherche d’antigènes et déclenchent à leur contact la réponse immunitaire (ce qui signifie habituellement la mort de l’ennemi). llCELLULES K. Ce sont les hooligans du système immunitaire. Subpopulation de cellules mononucléaires ni de type B ni de type T, ils possèdent tout de même les granulations caractéristiques. Sans reconnaissance spécifique, ils peuvent exterminer spontanément des cellules transformées (cancéreuses) ou infectées par un virus. lLa réponse immunitaire est orchestrée avec beaucoup de soin. Chaque type de cellule impliqué dans cette réponse est programmé génétiquement et outillé pour une tâche spécifique très spécialisée. llMACROPHAGES. Ils forment l’armée de terre errant par tout le corps et dévorant sans relâche les contaminants et autres envahisseurs qu’ils rencontrent. En sécrétant des produits solubles, les lymphocytes T spécifiques d’antigènes (CD4) stimulent leur activité et les rendent aptes à distinguer entre les cellules normales et les cellules transformées. llMASTOCYTES. Ce sont les météorologues. De grosses cellules (et leurs précurseurs basophiles) se lient de façon spécifique à une classe d’immunoglobulines qui, une fois couplées à un antigène, libèrent des amines vasoactives, surtout l’histamine. La libération de l’histamine est responsable de réactions allergiques cliniques. llCELLULES "T" SUPPRESSEUR. Ce sont les porteurs de drapeaux. Petits lymphocytes, ils signalent la fin du combat lorsque la victoire est complète. Ce sont eux qui disent aux lymphocytes T de cesser de se battre. Ils portent aussi le marqueur CD8. llCELLULES À MÉMOIRE. Ces cellules demeurent dans le corps après la première exposition ou infection. Ce sont les informaticiens éclaireurs entraînés à reconnaître un même ennemi au cours d’une invasion subséquente. llCELLULES "B" À MÉMOIRE. Leur fonctionnement est semblable à celui des cellules T à mémoire. Lorsqu’elles reconnaissent un ennemi qu’elles ont déjà rencontré une première fois, elles déclenchent leur « réponse secondaire » en produisant des anticorps d’une façon beaucoup plus rapide et plus intense que la première fois, comme des Marines. C’est ce qui constitue la base des vaccins d’immunisation. llLa réponse immunitaire est d’abord et avant tout une mesure de protection, mais si elle échoue dans sa fonction discriminante, une guerre civile éclate. Le corps traitera alors des cellules normales ou des parties de lui-même comme si elles étaient l’ennemi. Ce défaut de reconnaissance du soi est à la base de plusieurs maladies auto-immunes.lll
|
|